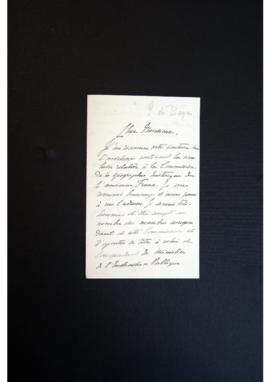« Une visite au château de Saint-Germain-en-Laye
Etat actuel, octobre 1855
Les monuments historiques de la France, leur origine et leur antiquité, ont de tous temps fixé l’attention des archéologues et des sociétés savates chargées de constater leur situation, les dégradations que le temps leur a fait subir et de signaler les réparations indispensables à leur conservation dans le style primitif.
La ville de Saint-Germain-en-Laye, fière de posséder l’un de ces monuments, va devoir à la munificence de l’Empereur la restauration de ce château, qu’admirent les étrangers et qui, après avoir passé dans les attributions du ministère de la Guerre, vient de rentrer dans le domaine de la Liste civile.
C’est à l’habile direction de M. Millet, architecte, aux soins duquel est confié un travail approprié à une destination non révélée, mais qui fait espérer une régénération de cette antique et royale demeure, que nous devons la réalisation d’un vœu si longtemps exprimé, en voyant la ville de Saint-Germain reprendre le rang qu’elle n’avait jamais cessé d’occuper parmi les résidences royales.
Sa configuration extérieure pouvant être appréciée généralement, nous avons pensé que, sans prétendre à aucun titre littéraire, mu par la seule idée de faire connaître à la génération présente la description intérieure de visu du château de Saint-Germain-en-Laye, dans son état actuel, avant les changements d’appropriation qu’il doit subir, pourrait intéresser quelques personnes, notamment celles qui l’ont vu après le délaissement de la Cour.
M. Lebreton, dans son excellent ouvrage d’antiquité, affirme qu’aucune nation de l’Europe ne peut disputer à la France la gloire qui résulte de ses monuments historiques. Pour répondre à une assertion si péremptoire et appuyée d’une si haute notabilité, il faudrait avoir, dans cet art, des connaissances tout autres que celles que nous apportions dans la rédaction de cet aperçu.
Nous passerons rapidement sur la partie historique de ce château, traité diversement par plusieurs auteurs, et que nous avons analysée dans notre Précis historique, publié en 1848, en cherchant à rapprocher ce qui était vraisemblable avec sa situation. Pour ne point indiquer au hasard une origine apocryphe, nous avons dû fixer nos regards sur le XIVe siècle. En effet, rien ne constate d’une manière positive qu’au Xe siècle, Robert le Pieux ait jeté les premiers fondements du château de Saint-Germain, mais bien d’un monastère nommé Charlevanne dont l’emplacement est contesté, et sur les fondations duquel Louis VI le Gros aurait, au XIIe siècle, selon quelques écrivains, fait construire, sous le ministère de l’abbé Suger, une forteresse que les Anglais auraient ruinée, et qui demeura dans cet état jusqu’au règne de Charles V, qui fit édifier, sur les anciens fondements, le château de Saint-Germain, dont l’architecture et les dispositions ont souvent varié selon les temps, ainsi qu’on peut s’en faire une idée par les gravures annexées au Précis historique dont il vient d’être parlé. Comme ce château fut, dans son origine, un monastère, puis une forteresse démolie, pour ne pas s’engager dans la recherche de cette origine douteuse et confondre ces anciennes constructions avec celles qui existent aujourd’hui, il est prudent de s’arrêter au règne de Charles V, en 1367, ce qui ferait supposer, avec quelque raison, que la construction du château de Saint-Germain-en-Laye, tel qu’il est aujourd’hui, daterait de 500 ans, c’est-à-dire qu’elle serait aussi ancienne qu’aurait été la Bastille, dont ce roi fit poser les premiers fondements en 1370 par Aubriot, prévôt des marchands de Paris, mais moins vieille que le château de Vincennes, où il est né en 1337.
Froissard et le président Hainault rapportent, dans leur Abrégé de l’histoire de France, que c’est dans la période de 1364 à 1370 que Charles V fit reconstruire ses châteaux de Creil, de Vincennes, de Beauté, de Mantes, de Montargis, etc., et dont celui de Saint-Germain fut sans doute du nombre.
On sait que les successeurs de Charles V, François Ier et les rois qui lui ont survécu jusqu’à Louis XIV, ont apporté chacun, pendant leur règne, divers changements, tant dans la forme que dans la distribution de ce château, sur lequel on fait très souvent des conjectures plus ou moins hasardées. Pour ne pas revenir sur ce qui a été dit à cet égard, nous renvoyons le lecteur de cet opuscule au Précis historique déjà cité.
Description intérieure
Nous nous abstiendrons, lors de cette description, de toutes réflexions et observations, ni d’émettre aucune opinion, voulant laisser au génie de l’architecte sa liberté d’action.
Pour arriver à l’entrée principale donnant sur la place du Château, fermée par une grande porte scellée à deux pilastres en pierre, on passe par un pont en pierre, construit lors de la restauration faite sous Colbert et remplaçant l’ancien pont-levis, dont on voyait encore la herse et la bascule suspendus à la voûte, au commencement de la Révolution. Cette entrée est une voussure en pierre, de 2 mètres d’épaisseur fermée par une autre grande porte ; à droite, est le logement du concierge, composé de deux grandes pièces ; à gauche, un corps de garde, le tout ayant vue sur la place du Château. Une grille en fer, tenue constamment fermée, sépare l’entrée principale d’avec celle de l’intérieur, aussi fermée par une grande porte à deux vantaux, avec guichet, donnant entrée dans la cour ; entre cette dernière porte et la grille qu’on vient de décrire règne, à droite et à gauche, une longue galerie ogivale, en briques, avec arceaux en pierre, encadrant en caisson les armes de François Ier ; à droite sont trois grandes pièces qu’occupait jadis le sieur Lemire, ancien plombier du roi : elles ont servir depuis à établir les bureaux de la comptabilité du pénitencier. En suivant cette galerie, on voit, à gauche, un petit escalier en pierre, qui conduit à la tribune de la chapelle, et, à droite, au fond, un carrefour presque noir, d’un assez vilain aspect, éclairé seulement par un vitrage, placé à l’extrémité du château ; à droite et à gauche de cette espèce de carrefour sont des pièces sombres, servant de dépôt de bois et de charbon.
En descendant quelques marches en pierre, on arrive dans une grande cuisine, éclairée sur les fossés, convertie en un vaste fournil, ayant servi à la manutention militaire des vivres ; en remontant cette galerie, à gauche de la porte d’entrée, sont des logements à rez-de-chaussée qu’occupaient jadis plusieurs officiers de la maison du Roi et, en dernier lieu, M. Desmarets, architecte du château. Ces logements ont été destinés depuis à ceux des sous-officiers du pénitencier, une pièce à la salle de police de ces sous-officiers, et les deux grandes pièces ensuite ont servi de magasin et de dépôt aux effets des prisonniers. Les séparations, qui divisaient ces grandes pièces et qui ont été démolies, ne permettent plus de reconnaître l’appartement qu’occupait alors milord Louis et sa sœur, aliénée, vulgairement nommée la Folle du château, ainsi que son neveu, milord Morice, qui fut, dans la première révolution, commandant de la garde nationale de Saint-Germain (ce même milord Morice épousa, à cause de sa beauté, la fille du portier de la grille Royale, nommée Longuemare).
C’est sous cette galerie, dans laquelle on a fait une séparation pour y établir le poste des gardiens de nuit, qu’étaient remisées autrefois les chaises et les brouettes de la Cour, et où se tenait le serdeau fréquenté par les jeunes gens et seigneurs de la Cour pour causer avec les jolies femmes chargées de ce service. A droite de cette galerie, est une porte pratiquée dans la tourelle du nord, conduisant à l’escalier, dit de la Comédie, dont nous parlerons ci-après.
[p. 137] Cour intérieure
On entre dans cette cour par la porte à guichet que nous avons décrite. Cette cour, de forme irrégulière, a 72 mètres de long sur 27 de large, et est pavée en grès.
Nous devons ici signaler l’erreur qui s’est perpétuée, et attribue à François Ier, par une galanterie pour Diane de Poitiers, sa maîtresse, d’avoir voulu donner à cette cour la forme d’un D gothique, initiale de son nom. Si l’on observe que c’est au XIVe siècle que Charles V a fait réédifier, sr ses anciennes fondations, le château de Saint-Germain, en déterminant le périmètre actuel de la cour, il sera difficile d’admettre que sa forme ait pu changer au XVe siècle, pour plaire à Diane de Poitiers, étant limitée par la construction principale.
Aux trois angles de cette cour sont des tourelles en pierre, dans l’intérieur desquels sont construits, en briques, des escaliers en limaçon conduisant sur les combles.
L’aile de droite, côté du nord, est construite en pierre et briques, selon le style du temps, procédant, comme tout l’ensemble de l’édifice, plus de la force que de l’élégance. Le rez-de-chaussée est éclairé par treize fenêtres cintrées, pratiquées dans un enfoncement que forment des avant-corps supportant un balcon continu en pierre, à jour, faisant le tour de la cour. Une porte cintrée avec colonnettes et fronton aussi en pierre, aux armes de l’Empereur, dix grandes bâches en pierre sont placées dans les embrasures de ces avant-corps et alimentées par des robines et conduits en plomb, amenant la portion d’eau appartenant à la Liste civile, pour le service de l’établissement. Au premier étage, quatorze grandes baies de fenêtres cintrées, à châssis brisés, à petits carreaux ; au deuxième étage, pareilles fenêtres moins grandes, avec balcons en fer, éclairent cette partie du bâtiment, sur la cour.
A droite de la porte ci-dessus décrite, conduisant à un grand escalier en bois, est un puits d’une grande dimension et d’une profondeur assez considérable, avec manivelle, dont la construction paraîtrait remonter au temps de la restauration faite sous François Ier.
La façade construite au fond de la cour, dans les deux angles rentrant que forment les deux tourelles, et l’aile faisant face à celui du nord, sont dans les mêmes dispositions ; quelques baies de fenêtres sont murées à la naissance des cintres, indépendamment de deux portes communiquant au rez-de-chaussée, et l’ouverture d’un porche sous lequel on passait par l’entrée principale, nommée la porte d’honneur, ayant son ouverture sur la rue du Château-Neuf, et son accès par un pont-levis en pierre, démoli lors de la construction et élévation des murs de ceinture ; ce porche et cette entrée ont été remplacés par un escalier de service.
A gauche et à droite des deux tourelles est et sud, est un troisième étage éclairé sur la cour par quatre croisées, avec balcon en fer. Sur les pilastres d’avant-corps, dont la restauration en plâtre a fait disparaître et recouvert la construction primitive en briques, sont quarante médaillons, au milieu desquels on a sculpté deux LL fleurdelysées, remplaçant les anciens médaillons en faïence de Bernard Palissy.
A droite de la porte d’entrée, dans la cour, est celle de la chapelle que François Ier fit réparer et qui date de l’époque où Charles V fit reconstruire le château. La voûte en ogive, ornée de fines arêtes dorées, est d’une rare délicatesse, modelée sur la Sainte-Chapelle de Paris, construite sous saint Louis, au XIIIe siècle. Cette voûte a vingt-quatre mètres d’élévation sous clef ; sa longueur est de vingt-cinq mètres et sa largeur de dix mètres. Elle fut dédiée à saint Jean-Baptiste ; elle est éclairée par de grandes fenêtres cintrées, vitrées en verres de couleur, soutenues par des arcs-boutants en pierre, qui s’appuient au-dehors sur le balcon. Louis XIII, qui passa une partie de sa vie dans ce château, donna des soins particuliers à la décoration de sa chapelle ; alors la voûte se couvrit de peintures de Vouet, de Lesueur et de Lebrun ; le tableau qu’on remarque sur le maître-autel est une copie que Louis XVIII a fait faire de la belle cène de Nicolas Poussin, dont l’original fut placé au musée du Louvre. Il fit aussi restaurer les tribunes et les boiseries qui avaient été endommagés lors de l’emmagasinement qu’on fit dans cette chapelle des lits militaires.
Une fouille récemment faite, près du pilier de droite en entrant dans cette chapelle, à la profondeur de soixante centimètres environ, et dans laquelle descendent les embases des cintres, ferait supposer que cette partie du sol aurait été remblayée lors de la restauration, pour le mettre de niveau avec la cour.
A droite du chœur de cette chapelle, séparée par une grille d’appui, est la sacristie, composée de deux pièces éclairées sur la rue du Château-Neuf, dont les boiseries ont été conservées.
Trente-cinq corps de sphynx, ou gargouilles en saillie, jettent dans les eaux des combles dans la cour.
Dans la tourelle du nord, à gauche en entrant, sont deux portes : la première communique de la cour à l’escalier dit de la Comédie, dont nous avons parlé, et l’autre, d’une plus forte dimension, donne entrée, par un escalier rapide et profond, aux caves et souterrains construits sous le château, dans lesquels on ne peut pénétrer qu’à l’aide de flambeaux et qu’on ne peut visiter sans éprouver un sentiment de terreur difficile à contenir. La première de ces caves, très vaste et très profonde, est solidement construite en pierre, avec arceaux, aussi en pierre ; à gauche sont d’autres caves traversant sous le pont et communiquant sous la galerie droite, en entrant.
A droite de la cave principale, est un petit couloir pratiqué dans des murs de trois mètres d’épaisseur, communiquant à plusieurs autres caves cintrées, en arceaux de pierre, et se prolongeant sous l’aile gauche, vers le milieu du château, où est pratiqué un petit escalier en pierre très droit et très obscur, dont l’issue est bouchée ; c’est dans ces caves, qui servaient de magasin à charbon, que l’ordre avait été donné d’arrêter et d’enfermer les insurgés qui, lors de la dernière révolution, s’étaient présentés pour mettre en liberté des prisonniers. Des stalactites et gouttes d’eau s’échappent de ses voûtes souterraines et impriment une froideur qui vous fait désirer d’en sortir.
En revenant sur ses pas, dans la première cave, on passe à droite dans un étroit couloir qui conduit à une autre cave, aussi construite avec arceaux en pierre, sur lesquels on remarque, notamment au-dessus de la porte voûtée, plusieurs blasons que nous avons figurés, paraissant avoir une origine ancienne. En tournant à droite, toujours par un corridor pratiqué dans l’épaisseur des murs en pierre de taille, on trouve une petite porte basse qui conduit, après avoir descendu quelques marches, à un souterrain en partie comblé, où aboutissaient les oubliettes dont il a été question dans le Précis historique. On voit dans ce souterrain très élevé, ayant dix mètres de long sur un mètre vingt-cinq centimètres de large, autant que peut le permettre l’obscurité qui règne dans l’élévation, une sorte de trappe de peu d’étendue, bouchée en moellons, d’où l’on précipitait, sans doute, dans un temps très reculé, les malheureuses victimes de la vengeance. Le conduit de ces oubliettes ayant été comblé jusqu’au niveau du sol, déjà très profond à l’endroit où nous étions descendus, nous ne saurions dire où il s’arrêtait.
Ces souterrains, qu’on quitte avec plaisir, ne sont pas plus profonds que ceux du château de Vincennes, bâti dans le même temps ; nous avons remarqué que les pierres dures, d’une énorme dimension, dont se composent ces constructions, bien appareillées, sont encore, malgré le temps et l’humidité, dans un parfait état de conservation.
En quittant ces affreux séjours, on remonte dans la cour, où l’on se trouve plus à l’aise, et comme ayant échappé à quelques périls cachés dans l’obscurité.
Avant d’introduire le lecteur dans l’intérieur de ce château, nous croyons devoir faire remarquer qu’à l’exception de quelques appartements que nous décrivons, il ne reste absolument rien de ce qui en faisait l’ornement et lui imprimait un caractère majestueux, digne d’admiration, sous le rapport de l’art, qu’on désirerait comparer avec les progrès qu’il a faits de nos jours. Ainsi toutes les portes, chambranles, boiseries, lambris à larges moulures dorées, parquets, décorations et généralement tout ce qui formait la division ou l’ensemble de chaque appartement, tout a disparu, a été démoli et vendu en différents temps, pour faire place à de nouvelles dispositions. Approprié depuis 1793 jusqu’à ce jour, d’abord à l’établissement de dépôt et magasin d’effets militaires, ensuite à l’incarcération des malheureux suspects, ou logement d’une compagnie de vétérans et du commandant de place, ensuite occupé, à d’autres époque, par les dépôts de divers régiments, par l’établissement de l’école spéciale de cavalerie, sous le commandement du général Clément de la Roncière, puis, après 1814, par les gardes du corps du roi, et enfin par le pénitencier militaire dont nous allons parler, il serait impossible aujourd’hui, même en rappelant ses souvenirs, d’indiquer l’endroit où était tel ou tel appartement, et de désigner ceux qu’occupaient les plus grands personnages de la cour les plus connus. Tout ayant été confondu et changé, il n’existe plus que les murs et d’énormes piliers nus et dépouillés de tout ce qui pouvait en faire reconnaître l’usage. Les immondices qu’on y rencontre, conséquence forcée de la suppression d’un établissement qui renfermait des ateliers de diverses fabriques, indiquent suffisamment la nécessité de pourvoir à la restauration de ce château, qui n’attend que l’ordre du souverain pour mettre l’architecte à même de nous faire connaître sa nouvelle destination.
[p. 141] Intérieur
En passant par la porte qui donne dans la tourelle du nord, on entre d’abord dans une grande salle séparée par des barreaux de bois, ayant servi de parloir ; ensuite, à gauche, au-rez-de-chaussée, dans de grandes pièces, au nombre de sept, éclairées, sur la cour et sur les fossés, par douze fenêtres cintrées, en pierre, prises dans l’épaisseur des murs, de trois mètres vingt centimètres d’épaisseur, défendus par des barreaux de fer ; les plafonds, de quatre mètres trente centimètres de hauteur, sont, comme tous ceux de ce monument, à solives apparentes, portées par d’énormes poutres, que soutiennent de fortes colonnes en bois ; chacune de ces pièces est séparée par des murs de refend en pierre, d’un mètre d’épaisseur, dans lesquels sont pratiquées des baies de porte formant couloir.
Dans chacune de ces vastes salles, qui servaient de réfectoire aux détenus, sont écrites, sur les murs, en lettres peintes, des maximes et moralités. A la sortie de la dernière pièce, à gauche, sous l’escalier, est un petit cabinet noir ayant servi de prison.
En tournant, d’abord à gauche, on entre dans de grandes pièces ayant servi d’ateliers ; ensuite, à droite et passant au pied de l’escalier de la tourelle nord-est, on entre dans deux grandes salles, séparées au milieu par un arc en pierre, éclairées sur les fossés par sept croisées que défendent des barreaux de fer, et où l’on avait établi des ateliers de forgerons.
Dans l’aile du sud, toujours au rez-de-chaussée, sont quatre grandes pièces ayant accès sur la cour, où avaient été aussi établis d’autres ateliers de forgerons et de petits magasins de charbon, le tout divisé par de longs corridors, qu’éclairent douze fenêtres cintrées en pierre, dans l’épaisseur des murs, lesquelles sont défendues par des barreaux de fer ; une salle de bains, avec ses fourneaux et accessoires, qui sont établies dans deux autres pièces, à gauche, prend jour sur la rue du Château-Neuf.
Toutes ces pièces, par la démolition des forges, fourneaux, établis, qu’on avait scellés, présentent un délabrement complet et pénible à décrire.
Pour suivre l’ordre que nous avons mis dans la description de cet intérieur, et afin d’éviter des contre-marches qui auraient pu faire oublier quelques pièces, nous reprendrons, pour la visite du premier et du second étages, par l’escalier de la Comédie, que nous avons déjà indiqué, au milieu duquel on trouve, à droite, une porte cintrée, donnant entrée à une grande antichambre, à cheminée en briques paraissant être d’un temps assez éloigné. C’est par cette antichambre que l’on entre, à gauche, dans la grande salle de Mars, dite des chevaliers, sous François Ier, dont nous allons faire la description.
Cette salle a quarante-sept mètres de longueur sur quatorze de largeur ; elle est éclairée par huit grandes fenêtres cintrées, donnant sur la place du Château ; la cheminée en briques est remarquable par son élévation et son architecture superposée ; elle porte en sculpture une salamandre et les armes de François Ier, en pierre parfaitement conservée ; de grands arceaux ogives, en pierre cannelée retombant sur des consoles à têtes d’ange, vont se joindre et forment la voussure en briques, parsemée de fleurs de lys en pierres saillantes, dont l’écartement est retenu par de forts tirants de fer. Cette pièce est partagée en deux dans sa hauteur, au moyen d‘un plancher en bois auquel on monte par un escalier-échelle, pour augmenter le nombre des ateliers ; c’est dans cette pièce qu’avait été construite la plus jolie salle de spectacle que l’on connût alors ; elle était entretenue dans un luxe royal, par les soins de M. le maréchal de Noailles. C’est là que débutèrent, devant la Cour, Larive, Saint-Prix, le célèbre Contat, etc. Molière y avait aussi fait représenter plusieurs de ses pastorales.
Cette salle, vendue dans le cours de la Révolution, à un sieur Dennebecq, qui avait obtenu l’autorisation d’y faire donner des représentations, a été démolie et disposée pour les exercices des gardes du corps.
[p. 142] En sortant de cette vaste salle, dont ne peut trop admirer la hardiesse, pour rentrer dans l’antichambre dont nous avons parlé, on passe, à gauche, dans un appartement complet, dépendant du pavillon du nord, éclairé sur la place du château et le parterre, où est décédé, dit-on, le roi Jacques II d’Angleterre. Cet appartement se compose d’une antichambre, d’un petit salon garni de lambris et panneaux dorés, chambranle de marbre vert de mer, oratoire, chambres à coucher, grand salon aussi à cheminée de marbre, salle à manger, office, cuisine, petits appartements des femmes, auxquels on monte par un petit escalier d’intérieur. C’est le même escalier, selon d’anciennes chroniques, qui conduisait nuitamment Louis XIV à l’appartement de mademoiselle de La Vallière, mais la simple inspection des lieux démontre l’impossibilité de cette rencontre. C’est donc le seul appartement conservé qui, quoique délabré, peut encore donner une idée de la somptuosité et des dorures dont le château était orné. On doit supposer que cet appartement fut aussi celui de la dauphine, si l’on s’en rapporte aux bas-reliefs composés de dauphins, ainsi qu’à son chiffre, entrelacé des lettres A. V. M., sculptés sur les panneaux dorés.
C’est en quittant ce lieu tout plein de souvenirs, qu’en repassant par la première antichambre que nous avons décrite, on arrive au premier étage, dans de grandes pièces parallèles à celles du rez-de-chaussée, divisées comme elles par les mêmes piliers et murs de refend. On y a établi les cellules qu’occupaient les détenus pendant la nuit ; on en compte cinq cents une, répartie dans chacun des étages du château. Ces cellules, quoique ayant bien le caractère d’une prison, ne sont cependant pas d’un aspect désagréable ; elles sont construites en double, adossées, dans ces grandes pièces, en cloisonnage, sans adhérence au monument, et soutenues par des traverses en bois de chêne, scellées dans le corps de l’édifice, pouvant facilement en être détachées sans l’endommager. Chacune de ces cellules à deux mètres cinquante centimètres de longueur sur un mètre cinquante centimètres de large, et sont proprement enduites et plafonnées : elles sont carrelées, mises en couleurs, fermées par une porte en chêne, avec serrure, et verrouillées comme l’exige la sûreté d’une prison. Une imposte vitrée au-dessus éclaire et donne de l’air à ce petit réduit, qui perd de son caractère de geôle par la propreté, le soin et l’intelligence avec lesquels chaque détenu a su l’embellir, pour charmer sa solitude et entretenir ses anciens rêves d’amour, ses souvenirs de gloire et d’infortune.
La plupart des malheureux jeunes gens, dont la justice avait puni les fautes, n’étaient pas sans éducation ni talent.
Presque toutes les cellules sont décorées, avec plus ou moins de goût, de peintures à l’huile et en détrempe, représentant divers sujets d’ornementation, draperies, arabesques, paysages, marine, faits militaires et historiques ; surtout des portraits, souvenir des belles de leurs pensées ; le tout traité en artiste, la plupart par une même main, autant qu’a pu le permettre la position d’un détenu privé de modèle et du secours de l’art. Quelques-uns se sont plu à représenter des sujets religieux. Nous avons remarqué saint Vincent de Paule, plusieurs ecclésiastiques, et la descente de croix de Daniel de Volterre, assez bien esquissée, composition difficile à reproduire par le souvenir, et que l’artiste n’a pas eu le temps d’achever : un long thème grec fait aussi partie de ces décorations.
En continuant cette visite du premier étage, du côté de la chapelle, on traverse plusieurs grandes pièces doubles en profondeur, éclairées sur la cour et la rue du Château-Neuf, consacrées aussi au service des ateliers de divers corps d’état. Passant à gauche par un corridor, on entre d’abord dans une pièce où se faisait la visite du médecin attaché à l’établissement du pénitencier ; puis dans deux grandes pièces communiquant l’une à l’autre, éclairées sur la rue du Château-Neuf, où se tenait l’école d’enseignement mutuel. Ces pièces sont encore garnies de bancs et tableaux pour cet usage. L’étage supérieur est disposé de même en ateliers pour diverses confections.
Après avoir quitté les salles que nous venons de décrire, en tournant à gauche, près d’une grille, on entre dans un appartement composé de six pièces, boisées et parquetées, qu’occupait le capitaine du pénitencier ; et, à côté, on entre aussi, par une porte à deux vantaux, dans un autre grand appartement dépendant du pavillon de l’ouest, éclairé sur la place du château, composé de douze pièces également boisées et parquetées, où logeait le commandant de l’établissement, et dans lequel XXXXXXX M. Jouy, de l’Académie française, auteur de la tragédie de Sylla. Les pièces que nous venons de décrire au premier étage sont toutes au niveau et donnent sur un grand balcon XXXXXXX supporté par des consoles en fer. Elles entourent XXXXXXX comme une ceinture, dont le parcours n’est interrompu que par une poterne convertie en lieux de retrait, donnant sur le parterre. On n’évalue pas à moins de 540000 kilog XXXXXXX employé à l’établissement de ce balcon, dont la solidité n’inspire aucune crainte.
Après avoir XXXXXXX l’escalier qui mène au logement du commandant, XXXXXXX parler, on arrive au fond de la galerie XXXXXXX et l’on fait ainsi, à l’intérieur, le tour du XXXXXXX l’exception de quelques petites pièces et cabinets XXXXXXX dépendances des appartements.
[p. 154] Il ne nous reste plus qu’à décrire les cinq pavillons qui flanquent ce château, et forment cet ensemble irrégulier dont la bizarrerie n’est pas sans mérite. Chacun de ces pavillons à trois étages de 130 marches au-dessus du balcon ; il est desservi par un escalier en pierre, pratiqué dans les tourelles intérieures, tournant en limaçon, lesquelles conduisent à la plate-forme du château, qui est dallée en pierre et entourée d’une balustrade d’appui, aussi en pierre pleine, jadis à jour et contournée, qui couronnait agréablement le monument. Il existe dans le pavillon sud un petit escalier en pierre, prenant naissance au premier étage et conduisant à deux cachots superposés, d’origine ancienne, au niveau du fossé, sur lequel ils reçoivent le jour. Ces cachots sont pris dans l’épaisseur des pierres, qui n’ont pas moins de deux mètres. Sur la tourelle du nord est une construction en pierre, avec escalier à l’intérieur, supportant la lanterne couverte en plomb et renfermant la sonnerie de l’horloge. Sur cette plate-forme, on découvre, aux quatre faces du château, un magnifique panorama, dont la vue se prolonge jusqu’aux bornes de l’horizon. En descendant ces escaliers jusqu’à la profondeur des fossés qui environnent le château, dans une largeur irrégulière de dix-huit mètres, entourés d’un mur en pierre, solidement construit, de sept mètres de hauteur, surélevé de deux mètres, avec tablettes en pierre (ces fossés, séparés par des murs, dans lesquels sont pratiquées des baies de porte, servaient de préau aux prisonniers), on arrive dans les parties basses des gros pavillons, où se trouvent de vastes cuisines cintrées, en pierre, à angles saillants, bien appareillées et dans un état parfait de conservation, d’une hauteur de six mètres cinquante centimètres sous clé, éclairées par de grands baies taillées en abat-jour dans l’épaisseur des murs. C’est dans ces cuisines que des cachots, au nombre de trente-sept, ont été établis pour y détenir temporairement les plus incorrigibles des prisonniers qui avaient mérité cette punition. La construction de ces cachots, dans lesquels l’air et le jour ont été ménagés, est semblable à celle des cellules que nous avons déjà décrites, sans aucune adhérence au corps principal, et autour desquels on peut librement circuler. Néanmoins on ne peut se défendre d’un mouvement de terreur en parcourant quelques-unes de ces cuisines, dont l’épaisseur des murs, d’environ quatre mètres, formant une sorte de couloir très sombre, donne à ces lieux un aspect sépulcral, qui rappelle les souterrains de la Bastille.
Bien qu’un puisard ait été creusé dans la partie ouest de ces fossés, près de l’entrée principale, l’écoulement des eaux s’opère difficilement, ce qui cause une humidité dont l’effet disparaîtra sans doute lors des réparations projetées. Comme le sol de ces cuisines est de niveau avec celui des fossés, il est peu probable qu’ils aient été remplis d’eau depuis leur construction. Une de ces cuisines, affectées vraisemblablement à chaque division du château, dont le service devait être pénible, surpasse les autres par sa grandeur et la largeur de sa cheminée, soutenue à l’aide d’un double anneau de pierre, et dans laquelle on pourrait facilement faire rôtir un bœuf.
Nous terminerons cette description par une visite au troisième étage, dans le pavillon du sud, côté du Château-Neuf. Là sont quatre salles de correction où l’on mettait les prisonniers qui refusaient le travail pour ne point les laisser trop longtemps au cachot, et afin de ne pas compromettre leur santé. Ces salles, grandes et bien aérées, sont éclairées, sur la rue du Château-Neuf, par des fenêtres recouvertes d’abat-jour.
On admire, dans la première salle, en entrant, le travail vraiment remarquable d’un prisonnier réfractaire, qui, pour charmer l’ennui de sa captivité, en déjouant la surveillance des gardiens, s’est amuré à sculpter, sans le secours de l’art, sur les deux embrasures de la fenêtre et dans l’épaisseur de la pierre, divers sujets, formant deux bas-reliefs qui ne seraient pas déplacés dans le cabinet d’un amateur, et décèlent un véritable artiste, dont ce n’est pas le coup d’essai. On voit, entre autres sujets demi-bosse, le portrait de Raphaël, tel qu’il est au Musée, une scène touchant Henri IV et Sully, le portrait de l’auteur, une vierge allaitant son enfant, Jeanne d’Arc sous un portique découpé à jour, et plusieurs autres sujets d’imagination, parmi lesquels on distingue, dans l’angle du mur, à gauche de ce bas-relief, une chaine composée de plusieurs mailles à jour et adhérente à la masse, qui ne pourrait s’en détacher qu’en la brisant ; ouvrage de patience et de dextérité, surtout si l’on observe que le grain de la pierre n’est pas propre à la sculpture, et que l’artiste avait peu d’outils pour exécuter un travail si compliqué, qui lui avait valu l’encouragement de M. le commandant et de l’officier du génie. Il serait à désirer, tant à cause de la singularité du sujet que du talent du prisonnier, que cette sculpture, dont nous avons relevé le dessin, fût conservée.
Que de réflexions font naître un pareil incident !... Pour se faire une idée de l’importance de ce grand monument, ajoutons qu’il occupe une superficie de un hectare cinquante-cinq ares seize centiares ; qu’il est éclairé par cinq cents baies et fenêtre ; que sa circonférence est de cinq cent trente-neuf mètres, et sa hauteur, de la base au sommet, de trente-trois mètres.
C’est dans cet état que le château de Saint-Germain-en-Laye a été remis de nouveau dans les mains de la Liste civile, qui s’est chargée de sa métamorphose. Après le licenciement des gardes du corps, qui y tenaient garnison, il fut remis au ministre de la Guerre, pour servir de pénitencier militaire, contre le vœu des habitants : c’est donc à cela qu’aboutit le faste de cette antique et royale demeure, où tous les talents furent mis à contribution, afin de l’orner et de l’embellir. Quand elle fut abandonnée par la Cour, on fit un noble usage des appartements qu’elle n’occupait plus ; au lieu de les laisser vacants, on en a fait l’asile du mérite infortuné ; on y comptait encore, au commencement de la Révolution, plusieurs familles distinguées, telles que madame la comtesse de Geslin et sa famille, M. l’abbé Deloge, madame de Pracontale, le commandeur Lafare, le chevalier de Mont-Flueyr, exempt des gardes, le chevalier Bazire, porte-manteau du Roi, M. de Commine, l’abbé Lecrin, auteur du loto-dauphin, l’abbé Brouin, chapelain du château, le sieur Dennebecq, propriétaire de la salle de spectacle, madame de Castelmore, madame Pompé, depuis épouse de M. Voisin, et parmi les étrangers réfugiés à la suite du roi Jacques II, lord Louis, sa sœur, lord Maurice, son neveu, etc. Tout a disparu ; le souvenir seul nous en est resté, pour faire place à cinq cents prisonniers, entrés au mois d’août 1836, sortis le 10 juillet 1855, après avoir séjourné dix-neuf années, sans avoir été ni agréables ni utiles aux habitants de cette ville. Disons cependant, comme un éloge mérité, que jamais pénitencier ne fut administré d’une manière plus paternelle, par d’honorables officiers, qui ont su concilier la rigueur de leur devoir avec la discipline et ce qu’on doit au malheur. Aussi, à part quelques cas d’insubordination, sévèrement punis, les prisonniers n’ont-ils jamais manqué, tant en santé qu’en maladie, de soins, de bons conseils et de consolations, que leur prodiguait l’honorable aumônier chargé de leur direction. Un travail salutaire et fructueux entretenait la santé du corps, en leur ménageant un secours pour l’avenir. L’ennui de leur captivité était tempéré par tout ce qui pouvait tendre à les distraire, en les instruisant des pratiques de la religion, en y joignant l’exercice des armes, de la gymnastique, de la danse, de la musique, de l’enseignement mutuel. Rien ne leur manquait pour en faire d’honnêtes gens et les faire revenir à de bons sentiments, que la liberté, qu’ils obtenaient souvent par un repentir sincère, une conduite exemplaire et une entière soumission à la discipline, base de toute institution militaire.
[p. 154] On ne sera sans doute pas étonné d’entendre ces éloges sortir de la bouche même d’un gracié, qui ne pouvait trouver d’ouvrage, ayant perdu l’habitude du travail de la terre. « Je souffre, disait-il, depuis huit jours, et suis plus malheureux que lorsque j’étais détenu au pénitencier de Saint-Germain ; j’y voudrais être encore ! »
Déjà l’on entend résonner le marteau qui commence l’œuvre de démolition de ces cellules. Et vous, artistes distingués, dont l’Empereur a fait choix pour seconder ses intentions, rendez-nous, par votre art, notre antique château digne du séjour d’une Majesté impériale que la gloire environne !
Le jour n’est donc pas éloigné où Saint-Germain, après bien des vicissitudes, reprendra son rang parmi les villes dont s’enorgueillit la France. Douée d’un site enchanteur, qu’embellissent des promenades variées, terrasse, forêt ombragée d’arbres séculaires, parc embaumé, artistement tracé, parterre fleuri, où l’on respire en air salubre et pur, cercle de verdure autour de la ville, se prolongent à l’horizon, tout concourt à faire de Saint-Germain une des villes les plus agréables des environs de Paris, surtout pour le séjour des étrangers, des artistes, des personnes riches et de bon goût, dont le délassement devient une nécessité, et qui choisissent de préférence le lieu le plus propice au développement de l’imagination et le plus favorable aux exercices du corps. Si l’on ajoute à ce tableau l’urbanité de ses habitants, les soins incessants qu’apporte une administration tutélaire, qui veille à la solidité de constructions élégantes, au pavage des rues, à l’établissement de larges trottoirs, à l’écoulement des eaux si longtemps réclamé, il serait difficile de méconnaitre les nombreux avantages qui se rattachent à la cité.
En voyant ses maisons blanchies et restaurées son église décorée de peintures sortant d’une habile main, un cercle, un théâtre et une garnison de la Garde, avec des marchés abondants, on comprendra que bien des gens veuillent habiter une ville charmante, rendez-vous de la bonne compagnie, et que l’on pourrait appeler, avec raison, le Windsor de la France.
Rolot »